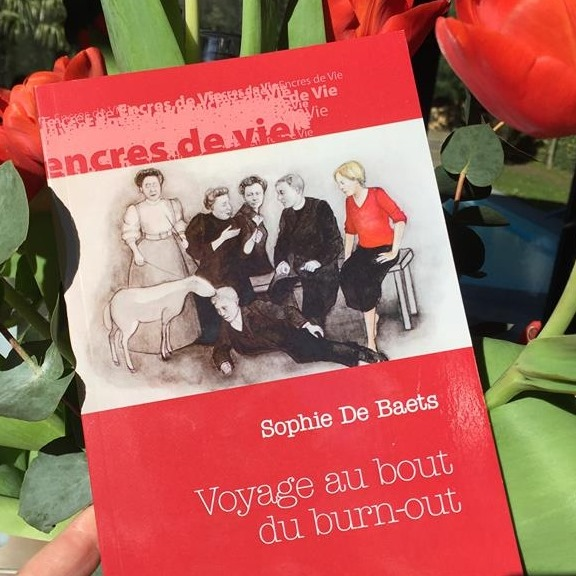Témoignage de Pierre Duray
La première chose qui m’a interpellé lorsque j’ai découvert l’Approche Narrative, c’est l’art de poser des questions. Ces fameuses questions qui permettent l’externalisation et le tissage dans les trois paysages à travers la ligne du temps. Mais surtout, ces questions qui mettent en avant la posture de l’accompagnant : décentrée et influente.
Cela me rappelle ma formation chez les ninja dont leur influence est clairement agissante mais leur présence est invisible. Et la similitude ne s’arrête pas là. Car comme le ninja, le praticien narratif, sans cesse s’adapte, rebondit sur ce que propose l’accompagné. Tout cela est motivé par le fait de sans cesse honorer l’histoire de la personne venant chercher de l’aide. C’est l’intention fondamentale.
Honorer les histoires, c’est quelque chose qui m’a profondément imprégné car cela marque un véritable respect pour la personne que nous avons devant nous. Ça lui confère le statut d’expert de sa vie. Quel changement d’attitude, quel apprentissage de l’humilité pour l’accompagnant. En l’occurrence ici : moi. Mais également quelle joie d’aiguiller la personne par ce fameux questionnement permettant les retrouvailles identitaires.
L'HISTOIRE D'UNE PERSONNE N'EST PAS SOLITAIRE
L’histoire d’une personne n’est jamais solitaire. Elle se construit en interaction avec les histoires qui construisent la communauté. Je trouve cette vision absolument merveilleuse et porteuse d’espoir.
Les liens, les histoires se tissent. Voilà qui me rappelle les Nornes. Ces déesses nordiques du Destin. Ce sont elles qui entremêlent ou dénouent les fils de nos destinées. J’aime imaginer notre participation, nous praticiens narratifs, voire notre collaboration avec ces déesses. Ça me rend joyeux. La joie, je dirais que c’est le filigrane de l’Approche Narrative. Surtout lorsque j’imagine l’accompagnement comme une exploration d’île en île. C’est tout une aventure, une découverte. J’espère que mon accompagnement sera dorénavant et définitivement une exploration d’île au trésor en île au trésor. D’ailleurs, combien de fois n’ai-je pas entendu le mot « pépite » dans notre formation.
EXTERNALISER LE PROBLEME
Je l’ai déjà citée mais j’y reviens un moment. Je veux parler ici de l’externalisation. Mettre le problème à distance en posant les « où », « quand », « comment », en lui donnant un « nom » est la meilleure concrétisation de cette affirmation : « Le problème est le problème, la personne n’est pas le problème ». Que peut-on faire de mieux pour rendre à l’accompagné son identité, sa dignité ?
Cette externalisation où le problème est bien identifié, caractérisé permet à l’accompagné une chose extraordinaire : prendre position. Pouvoir déclarer : « Non, ce problème ne me convient pas ! », est le début d’une révolution. C’est le commencement d’une nouvelle histoire : celle de l’exception. Toutes les fois où l’histoire dominante du problème était absente ou du moins, moins présente, ouvre la porte vers une ressource prouvant à la personne que c’est elle l’experte de sa vie et qu’elle est en mesure de changer les choses.
Dans mon accompagnement, j’ai souvent remarqué que les questions et les solutions mises en place par la personne en souffrance ne faisaient qu’alimenter l’histoire du problème en acceptant ou en s’infligeant des étiquettes. Comme si coûte que coûte, il fallait rester sourd à l’appel de l’AMI , l’Absent Mais Implicite. L’AMI vient en contraste de ce qui est dit, il révèle l’opposé à la complainte. Cette chanson douloureuse qui tourne en boucle de façon autonome. Mais encore faut-il pouvoir l’entendre cet AMI. C’est pour cela que le praticien narratif s’entraîne à acquérir la compétence de la double écoute.
Ecouter attentivement ce qui est dit pour pouvoir entendre le non-dit. Ce qui est sous silence mais qui est implicitement présent dans le récit nous projette directement dans le paysage de l’identité. En traversant ce paysage des valeurs et de l’identité profonde, la personne se donne le moyen de raconter une nouvelle histoire. C’est ce que nous appelons le Re-Authoring.
Grâce à l’exception et à l’AMI, non seulement une nouvelle histoire est possible mais la personne en est l’auteur. Elle devient un tisserand créant une œuvre à travers les paysages de l’identité, de l’action et de la relation. Tisser et épaissir l’histoire préférée en en étant l’auteur, voilà qui ajoute du bois au feu de la « révolution » individuelle et sociétale. Constamment se positionner dans l’antinomie du problème c’est-à-dire se permettre de regarder tout ce que le problème n’est pas. Un peu comme la mouche voulant absolument sortir par la vitre fermée alors que celle d’à côté est grande ouverte. Ne plus s’identifier à l’étiquette comme collé à la vitre fermée mais célébrer la liberté, sa propre liberté d’entrer dans une nouvelle communauté ou de réaffirmer son appartenance à une communauté.
Si nous avons amené de notre personne à la communauté, cette communauté au sens large nous a aussi forgés. Parfois empêtrés dans la toile sociale notamment à cause des étiquettes, nous avons aussi bien plus souvent que nous ne pouvons l’admettre été aidé, soutenu par cette communauté. Parmi celles-ci certaines personnes ont particulièrement été positivement influentes : c’est le club de vie.
Se repositionner par rapport à cette communauté dans ce que la personne accepte de recevoir et de donner c’est-à-dire constituer ou reconstituer son club de vie, c’est ce que l’Approche Narrative propose sous le terme « Re-membering ». Un jeu de mot en anglais qui a à la fois le sens de « se souvenir », « commémorer » et de « remembrer », « rassembler » dans l’idée de « reconnecter ». Le Re-membering se déroule en trois étapes : premièrement, la contribution des personnes croisées dans la vie de l’accompagné ; deuxièmement, qu’est-ce que l’accompagné a apporté aux personnes de son club de vie ; troisièmement, le Re-membering en lui-même, à savoir comment le fait de se souvenir des liens avec les membres de ce club de vie rebooste l’estime de soi.
RACONTER DEVANT DES TEMOINS
Un autre dispositif conversationnel constitue aussi la valise des moyens narratifs. Il s’agit du témoin extérieur. Une histoire n’existe que si elle est racontée. Oui mais racontée à qui ? Certes le praticien narratif est déjà un témoin mais il est capital que l’accompagné puisse replacer cette histoire dans son quotidien et dans un cadre de vie élargi. Le témoin extérieur me semble faire ce lien entre ces deux contextes : le cabinet narratif et la vie concrète. Cette oreille extérieure peut bien évidemment être un membre du club de vie voire même plusieurs personnes peuvent être présentes.
Ainsi, cette rencontre avec le témoin extérieur enclenchera la cérémonie définitionnelle. Ce sera probablement le moment le plus fort du parcours initiatique de reconnexion à son identité et ses valeurs. Enfin la personne pourra acter publiquement par une célébration sa nouvelle histoire. Peut-être aura-t-elle envie de narrer le chemin parcouru jusque cette nouvelle histoire ? Sera mise en place une cérémonie permettant une prise de position face à la communauté mais aussi une reconnaissance de la communauté à son égard par un symbole fort comme par exemple la remise d’un diplôme ou d’un certificat. Une manière très claire de marquer le coup entre l’avant et l’après mais aussi de souligner le courage d’avoir traversé le processus narratif.
Enfin, toute cette aventure d’île en île se terminera par un autre geste symbolique fort. Ce sera le temps de rendre le matériel narratif à la personne. Lettres, dessins, poésies, mindmap, cahiers remplis de rêves faits la nuit, prises de notes diverses et bien d’autres choses auront jalonné les entretiens narratifs. L’histoire de la personne lui appartient.
ECRITURE THERAPEUTIQUE, HYPNOSE ET NARRATION
Mais, qu’en est-il de ma pratique ? Comment concilier mes différents outils, les principaux étant l’hypnose, l’écriture thérapeutique et maintenant l’approche narrative ?
J’ai eu le déclic en écoutant une interview du Dr Julien Betbèze. On lui posait la question « Pourquoi dans certains accompagnements d’addictions (ici précisément le tabac) fonctionnent et dans d’autres pas ?». Lorsque la personne qui consomme a déjà une expérience de sécurité relationnelle, le tabac est « juste » un comportement à modifier. Mais lorsque l’addiction devient le support pour combler l’incapacité à être dans une relation sécure ou que les problèmes sont là depuis tellement longtemps qu’ils font partie de l’identité de la personne. Et c’est à cet endroit que l’approche narrative est intéressante.
Pour moi, tout s’éclaira. Bien évidemment qu’un abus sexuel engendre un problème identitaire, la personne étant dissociée afin de pouvoir survivre. Je l’ai compris depuis bien longtemps et je trouvais que l’hypnose comme je la pratiquais jusque-là n’était parfois pas l’outil le plus approprié. Idem pour les addictions qui font partie de l’énorme panoplie des effets possibles d’une agression sexuelle. Oui, il y a des addictions « identitaires » (celles qui ont « grandi » avec la personne) et effectivement, ce sont celles qui répondent le moins bien à l’hypnose suivant le schéma classique des inductions.
Et donc actuellement, je verrais l’approche narrative comme la valise contenant les autres outils plutôt que l’inverse. Ça fait beaucoup plus sens pour moi que de voir l’hypnose comme étant la valise.
L’Approche Narrative devient donc le cadre structurant dans lequel l’hypnose sera un catalyseur. Les nouvelles histoires, les changements de croyances, l’activation de ressources, donner de la puissance au métaphores, les désactivations d’ancres (ça je ne veux plus <> ça je veux), renforcer les dissociations utiles (externalisation) et nourrir les associations à la nouvelle identité, etc. , tout cela fait de l’hypnose un outil puissant et efficace à mettre au service de l’approche narrative.
Dans une autre interview, j’ai bien accroché au propos de Julien Betbèze. Il dit ceci : « Pour moi, la thérapie narrative est une conversation de nature hypnotique c’est-à dire une conversation qui permet à la personne de rentrer, d’habiter son corps et de sortir d’une logique qui est une logique cognitive basée sur la représentation pour rentrer dans un langage incarné. Et ce type de conversation, c’est un appel aux conversations hypnotiques. Le but de l’hypnose, c’est de permettre à quelqu’un de rentrer dans son corps et d’accueillir ses propres ressentis sensoriels. […] Est-ce que je couple les deux ? L’hypnose et la thérapie narrative ? Pour moi, la thérapie narrative, comme la thérapie systémique, comme la thérapie orientée solution sont trois conversations de nature hypnotique. Donc, l’hypnose, c’est simplement le moment où le processus de réassociation se met en place. »
Voilà qui pour moi est clair et ça m’ouvre la perspective sur un nouvel espace d’accompagnement. Et bien évidemment, ça implique une remise en question sur la façon d’accompagner le client. Force est de constater que de nombreuses fois, mon intervention, notamment lors de la détermination d’objectif, fut très violente et restrictive pour la personne. J’avais bien senti que quelque chose n’allait pas et j’ai trouvé réponse à mon questionnement.
Les choses se sont déjà bien enclenchées. L’externalisation et l’exceptions sont maintenant bien intégrées à ma pratique. Et d’autres choses qui étrangement se mettent en place toutes seules dans la conversation.
En conclusion, je dirais que autant j’ai été ébloui par la puissance de l’hypnose autant je me sens oxygéné par l’Approche narrative. Je me sens libéré d’une contrainte de « performance » pour un accompagnement réellement teinté d’amour. Et c’est dans cette voie que je désire aujourd’hui m’engager.
Pierre Duray